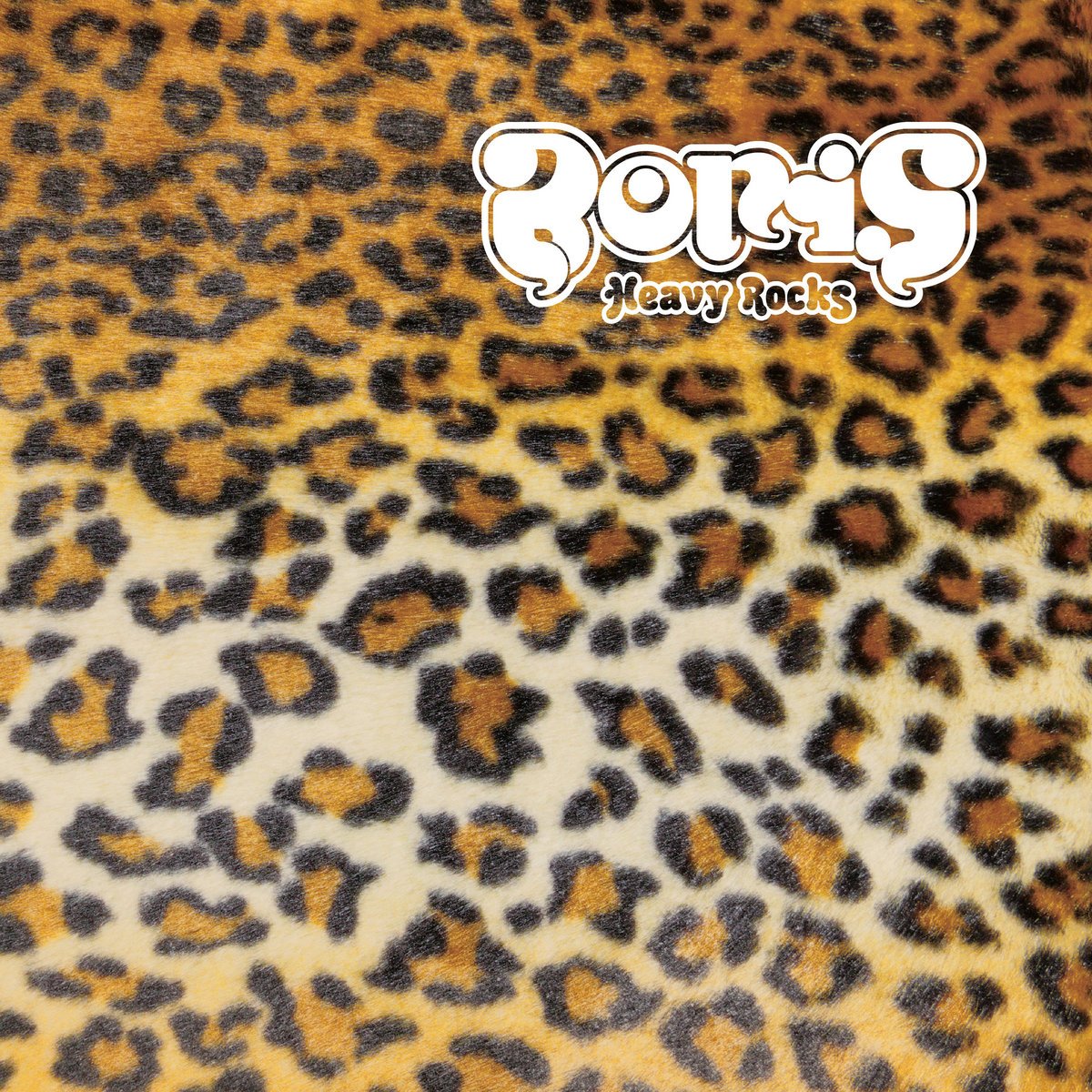Roches lourdes (2022) est le troisième d’une série de Boris‘ Roches lourdes records qui tentent d’aller au-delà du rock arcane des années 70 et des boules de proto-métal avec un appareil de frappe avant-gardiste / expérimental bordé de goudron de pin. Dans un bon jour, la ligne Boris ont tracé entre le passé et le présent au cours de 28 (jeesus putain de christos!) albums et d’innombrables EP/albums live/splits/et ainsi de suite ressemble plus à une hélice qui tourne, se courbe, serpente autour de la régularité, apparaissant et disparaissant au-dessus d’un horizon rock, punk et métal. Sous le plus grand parapluie du monde, bassiste/guitariste Takeshi Ohtaniguitariste Mizuno « Wata » Yoko et batteur/chanteur Atsuo Mizuno pourrait être considéré comme un groupe de rock stoner. Wikipédia choisit de ne pas les qualifier de « groupe de musique expérimentale » tandis que les gardiens normalement perspicaces de Metal Archives ont simplement leur genre répertorié comme « divers ». Je ne peux pas nier tout ce qui précède et le plus récent Roches lourdes ajoute plus de carburant à ceux-ci et à toute classification que n’importe qui pourrait proposer mais, selon le titre et l’intention de la série, le fait avec la lourdeur à l’esprit. Comprenez cependant que BorisL’idée en constante évolution de « lourd » ne correspond probablement pas à ce qui viendrait normalement à l’esprit de la plupart des gens qui s’arrêtent sur un site Web appelé Metal Injection.
Malgré la chaleur sonore qui accompagne les murs d’amplification vintage, (vraisemblablement) l’enregistrement sur bande et une batterie étincelante qui semble avoir été préservée cryoniquement depuis qu’elle est tombée de l’arrière du camion d’équipement lors de la deuxième étape de Sabbat noirc’est Maître de la réalité tournée, il y a un air sous-jacent de bizarre qui pousse cela au-delà d’être simplement un disque de rock fort décent avec les années 1960 et 70 dans sa ligne de mire.
Le premier banger « She is Burning » regorge de tropes rock torse nu comme des guitares plus floues que Roi Buzzo‘s ‘fro, trilles joués comme s’ils se démodaient, pété deux temps, bâclé Hendrix– comme la livraison de la mélodie et plus de flexion des cordes que la dernière flexion des cordes. Tout cela est empilé par des cors simulés, des couches sur couches d’interjections de pistes vocales (avec des lignes juste assez décalées pour être perceptibles, mais qui fonctionnent toujours) et Jean Zorn-comme un bêlement de saxo. Le riff peut sembler familier, mais comme il est augmenté de tous ces sons, bruits et effets étrangers, il donne à la fadeur de la chemise de concert rock classique trop chère un air de chaos intempérant. Sur cette même pointe se trouvent « Question 1 » et « Ruins », l’ancien gussies un galop D-beat thrashy avec des lignes de basse ambulantes et des voix en son surround avant de se rendre à 2001 : L’odyssée de l’espace immensité enracinée dans le battement de tambour spacieux et le lancer de hache callithumpien, tandis que ce dernier est à peu près aussi droit sur la pointe hardcore à bascule que Boris peut-être jamais été.
« Cramper » est comme si quelqu’un avait présenté le Frères Blues à une combinaison des Melvins et des sorties audio hentai. Beaucoup de « Woo! » vocalisés et Wolfman Jack des hurlements sont présentés à côté de ce que nous pensons être des paroles sur quelqu’un « vraiment rock » pour injecter à celui-ci une merde d’énergie viscérale et d’espièglerie alors que « My Name is Blank » exploite Watala véracité de la sélection aux côtés de ce qui semble être des boucles de bande et des chants de bain d’acide.
L’aspect expérimental ressort davantage dans des morceaux comme « Blah Blah Blah » à la basse et sa juxtaposition de free-jazz, de noise rock et de slashs d’effets apparemment aléatoires, de saxo rap et de percussions de junkyard avec un refrain qui sonne comme Pat Benatar se frayant un chemin à travers l’atelier automobile de la dernière année. Et « Ghostly Imagination » déchire comme Motörhead-se rencontre-Ruéemais avec ce qui ressemble à un héros numérique hardcore Alec Empire tenir la boîte à rythmes. Ces deux-là fonctionnent. D’autres excursions plus avant-gardistes, comme « Nosferatu », sont plus le son du groupe qui perd l’intrigue et fait du racket pour le plaisir de faire du racket et l’appelle de l’art intello dans une présentation low-brow. Et le gémissement vocal sans mélodie rappelant un « Love Hurts » étranglé par-dessus Clous de neuf pouces La rareté du piano comprenant « (not) Last Song » est en fait une déclaration de sortie terrible, mais heureusement, ce n’est pas un moment fini. Après quelques centaines de sorties, c’est à peu près une garantie que ce n’est pas la fin de ce groupe qui repousse les limites et, espérons-le, pas la fin du Roches lourdes série.